Louis-Ferdinand Céline, né le 27 mai 1894 à Courbevoie, et mort le 1er juillet 1961 à Meudon, connu sous son nom de plume généralement abrégé en Céline, est un écrivain et médecin français. Il est considéré comme l’un des plus grands novateurs de la littérature française du xxe siècle. Il est notamment célèbre pour « Voyage au bout de la nuit », une sorte de roman moitié autobiographique moitié fictif, publié en 1932.
Il est de ces écrivains dont, après avoir effectué une première incursion dans leur oeuvre, l’on a la furieuse envie de tout dévorer. Ce fut mon cas après ma lecture du Voyage. J’ai lu Voyage au bout de la nuit il y a …plus de 10 ans et j’ai des souvenirs très précis non seulement sur la trame du roman (qui exprimait une partie de cette soif d’immigration en moi) mais effectivement sur le style unique de Céline et sur le malaise que j’avais en le lisant. C’est vrai que c’est à la fois brillant et nauséeux.
Le roman nous fait suivre les tribulations d’un personnage, Ferdinand Bardamu, de la veille de la première guerre mondiale jusqu’aux années 30. Tourbillon de réalisme, de pessimisme et de noirceur. Céline nous décrit sa vie, ses expériences de la guerre, du colonialisme ou de l’Amérique, sa vision de l’Homme. Le livre commence par une discussion enflammée Place Clichy à Paris entre Ferdinand et Arthur, son camarade étudiant en médecine comme lui, et voilà Ferdinand Bardamu engagé dans l’armée pour combattre ; nous sommes en 1914, année de la 1ere guerre mondiale. Ainsi démarre ce long voyage au bout de la nuit. Le voyage de Ferdinand, alors jeune homme idéaliste plein d’idées pré conçues sur la vie et les humains, est un périple initiatique. A l’armée, il n’y restera pas longtemps dégoûté des horreur de la guerre, il sera ensuite hospitalisé, puis partira en Afrique travailler dans les colonies où ils sera confronté a la réalité de la colonisation, puis en Amérique en pleine révolution industrielle où il se confrontera au capitalisme en travaillant comme ouvrier chez Ford avant de rentrer en France, finir ses études de médecine et s’installer dans un quartier populaire de Paris. Son voyage se termine dans une clinique psychiatrique où il prend en charge la maladie mentale au côté d’un docteur Baryton plus que caricatural. Au cours de son périple, Ferdinand rencontrera toute une galerie de personnage dont il nous fait partager les défauts et les qualités, les forces et les faiblesses.
La façon dont Céline décrit les situations et les personnages permet en quelques lignes de ressentir les atmosphères, visualiser les personnages. On saisit l’âme profonde de l’être humain, sa lâcheté, sa misère, sa rudesse, sa pauvreté. On comprend la bêtise, l’absurdité des décisions des « grands ».
Ce livre est très proche de la déconstruction qu’opère Nietzsche dans sa « Généalogie de la Morale ». Nietzsche montrant que des valeurs comme la bonté, la gentillesse ne sont que des valeurs nihilistes et donc nuisibles et Celine quant à lui montrant l’absurdité de valeurs telles que la bravoure, le patriotisme (1ère partie: la guerre), l’esprit d’aventure (2ème partie: l’Afrique), les valeurs en général du capitalisme (3ème partie: l’Amérique) etc. En lisant ce roman, on a l’impression d’assister à un constat sur le monde certes justifié mais dont on ne trouve aucune issue et qui semble bien nihiliste. A part les quelques rayons de soleil qui éclairent le voyage (Moly son amoureuse américaine en particulier, l’amour et l’amitié en général), la déconstruction est totale, tout y passe!
Extraits :
« Faire confiance aux hommes, c’est déjà se faire tuer un peu. »
…
« On n’est jamais très mécontent qu’un adulte s’en aille (meure), ça fait toujours une vache de moins sur la terre, qu’on se dit, tandis que pour un enfant, c’est tout de même moins sûr. Il y a l’avenir… »
« Tant qu’il faut aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu’avec les hommes, on a au moins l’excuse d’espérer qu’ils seront moins carnes que nous autres plus tard. On ne savait pas. »
…
« Elle me conseillait bien gentiment, elle voulait que je soye heureux. Pour la première fois qu’un être humain s’intéressait à moi, du dedans si j’ose dire, à mon égoïsme, se mettait à ma place à moi et pas seulement me jugeait de la sienne, comme tous les autres.
Ah ! si je l’avais rencontrée plus tôt, Molly, quand il était encore temps de prendre une route au lieu d’une autre ! Avant de perdre mon enthousiasme sur cette garce de Musyne et sur cette petite fiente de Lola ! Mais il était trop tard pour me refaire une jeunesse. J’y croyais plus ! On devient rapidement vieux et de façon irrémédiable encore. On s’en aperçoit à la manière qu’on a prise d’aimer son malheur malgré soi. C’est la nature qui est plus forte que vous, voilà tout. Elle nous essaye dans un genre et on ne peut plus en sortir de ce genre-là. Moi j’étais parti dans une direction d’inquiétude. On prend doucement son rôle et son destin au sérieux sans s’en rendre bien compte et puis quand on se retourne il est bien trop tard pour en changer. On est devenu inquiet et c’est entendu comme ça pour toujours.
Elle essayait bien aimablement de me retenir auprès d’elle Molly, pour me dissuader… » Elle passe aussi bien ici qu’en Europe la vie, vous savez, Ferdinand ! On ne sera pas malheureux ensemble. » Et elle avait raison dans un sens. » On placera nos économies… on s’achètera une maison de commerce… On sera comme tout le monde… » Elle disait cela pour calmer mes scrupules. Des projets. Je lui donnais raison. J’avais honte de tant de mal qu’elle se donnait pour me conserver. Je l’aimais bien, sûrement, mais j’aimais encore mieux mon vice, cette envie de m’enfuir de partout, à la recherche de je ne sais quoi, par un sot orgueil sans doute, par conviction d’une espèce de supériorité.
Je voulais éviter de la vexer, elle comprenait et devançait mon souci. J’ai fini, tellement qu’elle était gentille par lui avouer la manie qui me tracassait de foutre le camp de partout. Elle m’a écouté pendant des jours et des jours, à m’étaler et me raconter dégoûtamment, en train de me débattre parmi des fantasmes et les orgueils et elle ne fut pas impatientée, bien au contraire. Elle essayait seulement de m’aider à vaincre cette vaine et niaise angoisse. Elle ne comprenait pas très bien où je voulais en venir avec mes divagation, mais elle me donnait raison quand même contre les fantômes ou avec les fantômes, à mon choix. A force de douceur persuasive, sa bonté me devint familière et presque personnelle. Mais il me semblait que je commençais alors à tricher avec mon fameux destin, avec ma raison d’être comme je l’appelais, et je cessai dès lors brusquement de lui raconter tout ce que je pensais. Je retournai tout seul en moi-même, bien content d’être encore plus malheureux qu’autrefois parce que j’avais rapporter dans ma solitude une nouvelle façon de détresse, et quelque chose qui ressemblait à du vrai sentiment. «
….
« La vie c’est une classe dont l’ennui est le pion, il est là tout le temps à vous épier d’ailleurs, il faut avoir l’air d’être occupé, coûte que coûte, à quelque chose de passionnant, autrement il arrive et vous bouffe le cerveau. Rien qu’une simple journée de 24 heures c’est pas tolérable. Ca ne doit être qu’un long plaisir presque insupportable une journée, un long coït une journée, de gré ou de force. »
…
« Les jeunes c’est toujours si pressés d’aller faire l’amour, ça se dépêche tellement de saisir tout ce qu’on leur donne à croire pour s’amuser qu’ils y regardent pas à deux fois en fait de sensations. C’est un peu comme ces voyageurs qui vont bouffer tout ce qu’on leur passe au buffet, entre deux coups de sifflet. »
…
« … vous êtes intelligent, ne restez pas en France, allez tenter la fortune en Amérique, à New-York ; ici, le prolétaire intelligent devient révolutionnaire, là-bas, il fait parfois fortune. » C’est ses propres paroles. « Ici, qu’il me disait, vous appartiendrez toujours à la classe si intéressante des huit millions de salariés français qui ne gagnent pas cinq cents francs par mois ; c’est assez pour être patriote, ce n’est pas assez pour bouffer, l’expérience le prouve. Foutez le camp, mon ami, autrement vous allez devenir communiste, ce qui n’est pas non plus une manière de se nourrir. »
…
« Etre seul c’est s’entraîner à la mort. »
« La plupart des gens ne meurent qu’au dernier moment ; d’autres commencent et s’y prennent vingt ans d’avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre. »
…
« Dans ce métier d’être tué (soldat), faut pas être difficile, faut faire comme si la vie continuait, c’est ça le plus dur, ce mensonge. »
…
« …Lola, après tout, ne faisait que divaguer de bonheur et d’optimisme, comme tous les gens qui sont du bon côté de la vie, celui des privilèges, de la santé, de la sécurité et qui en ont encore pour longtemps à vivre.
Elle me tracassait avec les choses de l’âme, elle en avait plein la bouche. L’âme, c’est la vanité et le plaisir du corps tant qu’il est bien portant, mais c’est aussi l’envie de sortir du corps dès qu’il est malade ou que les choses tournent mal. On prend des deux poses celle qui vous sert le plus agréablement dans le moment et voilà tout ! Tant qu’on peut choisir, entre les deux, ça va. Mais moi, je ne pouvais plus choisir, mon jeu était fait ! J’étais dans la vérité jusqu’au trognon, et même que ma propre mort me suivait pour ainsi dire pas à pas. J’avais bien du mal à penser à autre chose qu’à mon destin d’assassiné en sursis, que tout le monde d’ailleurs trouvait pour moi tout à fait normal. »
…
» Tout ce qui est intéressant se passe dans l’ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. «
…
« Si les gens sont si méchants, c’est peut-être seulement parce qu’ils souffrent, mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir de celui où ils deviennent un peu meilleurs. »
…
« La vérité, c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité de ce monde, c’est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n’ai jamais pu me tuer moi. »
« Nous sommes, par nature, si futiles, que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. »
…
« Autant pas se faire d’illusion, les gens n’ont rien à se dire, ils ne se parlent que de leurs peines à eux chacun, c’est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. Ils essayent de s’en débarasser de leur peine, sur l’autre, au moment de l’amour, mais alors ça ne marche pas et ils ont beau faire, ils la gardent tout entière leur peine, et ils recommencent, ils essayent encore une fois de la placer. »
…
« Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le reste n’est que déception et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est un roman, rien qu’une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d’abord tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C’est de l’autre côté de la vie. «
…
« Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment, ils ont l’air de rien les mots, pas l’air de dangers bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chauds, ni froids, et facilement repris dès qu’ils arrivent par l’oreille par l’énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d’eux des mots et le malheur arrive.
Des mots, il y en a des cachés parmi les autres, comme des cailloux. On les reconnaît pas spécialement et puis les voilà qui vous font trembler pourtant toute la vie qu’on possède, et tout entière, et dans son faible et dans son fort… C’est la panique alors… Une avalanche… On en reste là comme un pendu, au-dessus des émotions… C’est une tempête qui est arrivée, qui est passée, bien trop forte pour vous, si violente qu’on l’aurait jamais crue possible rien qu’avec des sentiments… Donc, on ne se méfie jamais assez des mots, c’est ma conclusion. »
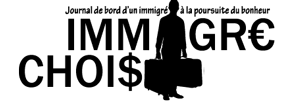


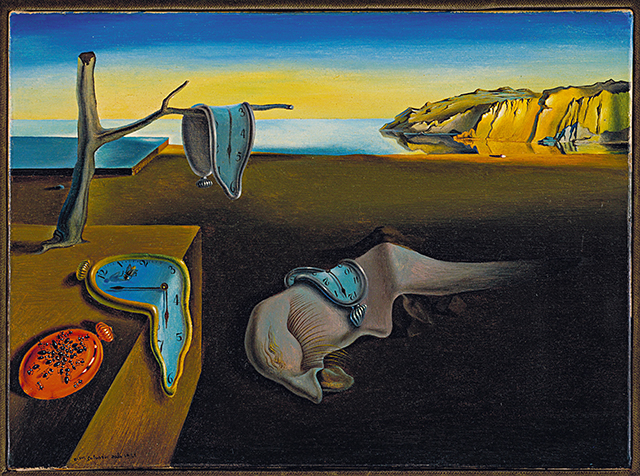



Je trouve que le nihilisme total de Céline finit par se transformer en un amoncellement de platitudes, même si je reconnais que certains passages de Voyage au bout de la nuit sont très forts (en particulier dans la partie étasunienne du récit ). On trouvait déjà ce pessimisme absolu dans Candide de Voltaire. Nietzsche, Rimbaud et Flaubert ont eux aussi opéré cette forme de « déconstruction » idéologique mais ils ont également montré qu’il existait des moyens d’échapper à l’aliénation du monde (par l’amour, l’art, la poésie). D’ailleurs Nietzsche se voulait un adversaire du nihilisme et non un nihiliste : pour lui les croyances religieuses ou politiques étaient des « nihilismes » dont il fallait s’émanciper. Ce que je reproche à Céline, c’est de se complaire dans la description systématique du mal et du sordide, comme l’avaient fait avant lui Balzac et surtout Zola, et d’autres romanciers plus ou moins passés aux oubliettes. Au vingtième siècle c’est devenu une sorte de poncif littéraire, et au siècle actuel, et au siècle actuel c’est toujours le cas .
@Yeux de Lynx,
Je trouve au contraire le nihilisme de Celine plus profond justement parce quil ne donne aucune porte de sortie contrairement a Nietzsche. Le bout de la nuit c’est le hurlement d’une société aux prises avec sa propre mort. La mort ; sa réponse à la question qui s’est posée à lui au contact de la guerre : n’y a-t-il pas chez l’homme un désir de tuer et de se tuer ?
Je différencie le nihilisme au niveau collectif (la folie furieuse et la bêtise sont une fatalité dans toutes les sociétés, pour moi c’est un fait ) et le nihilisme au niveau individuel. Le propre de l’art et de la poésie est de montrer qu’il existe pour chacun des valeurs supérieures à celles de toute société (la passion amoureuse, la beauté, le rêve) et qu’il est possible de s’affranchir de la folie collective en les suivant. C’est en cela que réside l’individualisme révolutionnaire d’un Baudelaire, d’un Nietzsche, d’un marquis de Sade ou des surréalistes. Ou de Rimbaud, Van Gogh, Villon, Poe etc … Comme dans le film de Jean-Luc Godard « Alphaville » que vous connaissez peut-être : à la fin tout ce monde totalitaire sombre dans le chaos, sauf les deux héros qui parviennent à s’en échapper grâce à leur passion amoureuse commune et au livre « Capitale de la douleur » d’Eluard. C’est d’ailleurs à mon sens ce pourquoi les poètes et écrivains importants sont presque toujours en conflit avec la société et l’époque où ils vivent : le seul moyen d’être et de créer est de se hisser au-dessus, d’être plus ou moins asocial ou à la marge (y compris ceux qui réussissent et sont célèbres de leur vivant, comme Goethe ou Hugo). Cordialement .